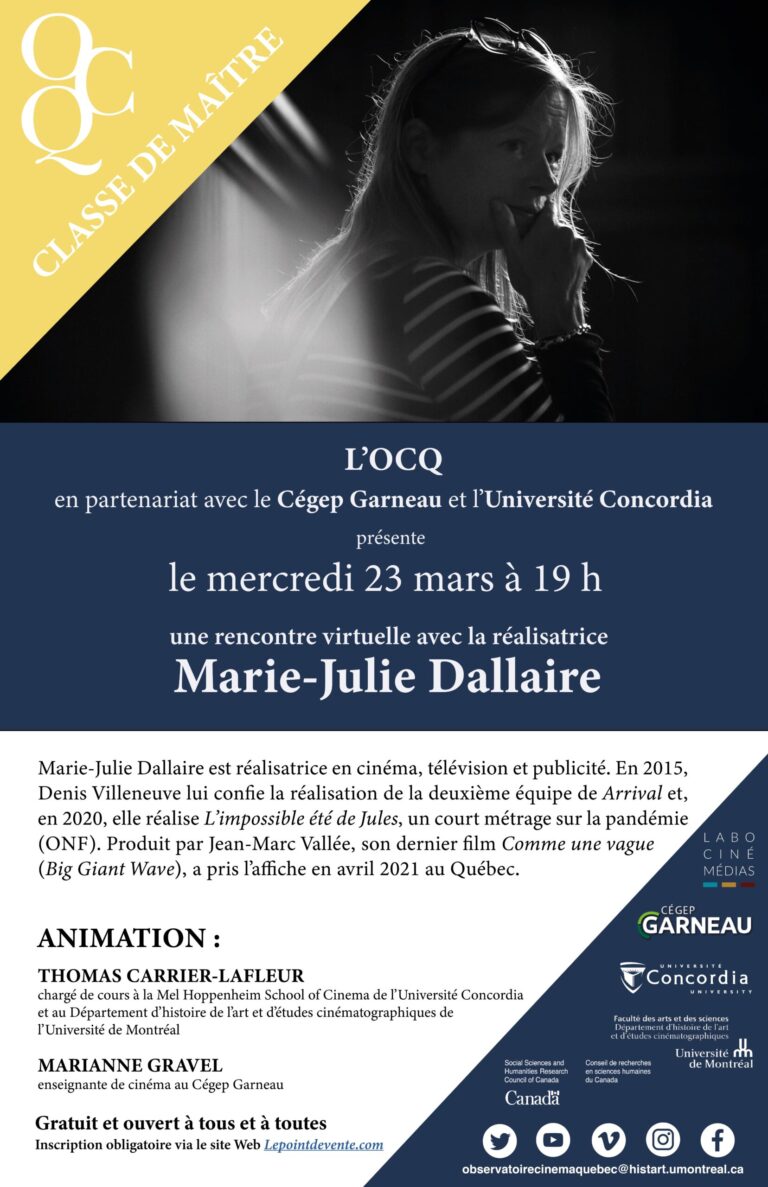La doctorante met à profit ses recherches sur la fonction poétique du scénario dans une analyse de rapports de rêves pour le Laboratoire CinéMédias.

Sophie Leclair-Tremblay
Au fil de ses études, la doctorante en cinéma à l’Université de Montréal Pauline Sarrazy a acquis des compétences non seulement en études cinématographiques, mais aussi en analyase de textes. Sa thèse, menée sous la direction d’Isabelle Raynauld, codirectrice de cinEXmedia, s’intéresse ainsi à la poésie propre au scénario depuis un angle esthétique – une approche qu’elle applique également à l’étude de rapports de rêves, dans le cadre d'un projet mené par Santiago Hidalgo au Laboratoire CinéMédias.
Pauline Sarrazy a récemment retenu l’attention de la communauté étudiante : elle a remporté le premier prix de la finale locale du concours « Ma thèse en 180 secondes » et elle représentera l’Université de Montréal à la finale nationale lors du prochain congrès de l’Acfas, le 7 mai.
C’est la lecture du scénario du film La Leçon de piano (1993), écrit et réalisé par Jane Campion, qui lui a inspiré son sujet de thèse. « Cette trouvaille a provoqué de grands chocs en moi, a-t-elle raconté lors de sa performance. Le premier fut de constater la rareté de cet objet. En France et au Québec, seuls cinq à dix scénarios sont publiés chaque année, contre des centaines de pièces de théâtre. Pourquoi ? Parce que le scénario est encore perçu comme un texte neutre, sans style, uniquement destiné à la production. »
« Guider la réception sensible de l’œuvre »
La chercheuse s’intéresse à la poésie inhérente au scénario, qu’elle voit comme une façon de « guider la réception sensible de l’œuvre, car elle recèle en elle-même les éléments de mise en scène ainsi que l’âme du film », explique-t-elle en entrevue. « La poésie scénaristique inclut notamment les indications techniques relatives au son, à la lumière ou au montage. C’est ce qui permet, finalement, de guider l’expressivité poétique du matériau audiovisuel du futur film. »
Cette approche va à l’encontre de nombreux manuels d’écriture scénaristique, qui préconisent un style minimaliste, neutre et technique pour ne pas entraver à la clarté de réalisation du film à produire. Elle ouvre néanmoins d’étonnantes perspectives sur l’écriture de scénario, que la doctorante explore comme un lieu où « la poésie réside sous les mots et les images ». « En tant que scénariste, nous habitons l’écriture d’un rapport singulier au monde. Lire un scénario, c’est alors s’ouvrir au partage sensible qui nous est transmis autant que d’éveiller la sensibilité singulière de notre imaginaire cinématographique.

Sa thèse s’appuie sur les scénarios de cinéastes tels que Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Chantal Akerman et Bruno Dumont. Pour elle, ces artistes, considérés par la critique comme des « poètes de la caméra » font naître la poésie non pas seulement au moment de la réalisation filmique, mais dès la création scénaristique. Elle étudie également des scénarios non réalisés d’Antonioni, qu’elle considère comme une part importante de son œuvre.
Dialogue entre rêves et cinéma
Pauline Sarrazy fait aussi partie d’une équipe qui s’intéresse à l’influence du cinéma sur les rêves au sein du Laboratoire CinéMédias. Outre la doctorante, l’équipe est composée de Santiago Hidalgo (directeur du partenariat), Thomas Carrier-Lafleur (directeur adjoint et coordonnateur de la recherche), Tara Karmous (coordonatrice principale), Rosalie Carignan (adjointe à la coordination), Pierre Chemartin (professionnel de recherche) et de Félix Raymond (auxiliaire de recherche).
Son rôle consiste à analyser les « traces du langage cinématographique » dans des rapports de rêves recueillis par le Laboratoire de recherche sur les rêves de l’Université de Montréal, dirigé par le spécialiste du sommeil Antonio Zadra. Ces documents, produits en contexte clinique, sont des descriptions de rêves rédigées par des patients et des patientes et formulées lors de certaines phases précises de leur sommeil.
« Quand tu rêves, tu peux te percevoir de l’extérieur comme l’on observerait un personnage de film, ou à l’inverse fondre ta perception à son regard comme dans le cas de la caméra subjective, explique Pauline Sarrazy. Les points de vue interne et externe, le “je” personnage et le “je” narrateur, sont des éléments scénaristiques qu’on retrouve aussi dans les rêves. » Elle souligne ainsi les parallèles qui existent entre l’écriture scénaristique et l’écriture onirique : « Les séquences, le montage, les aspects audiovisuels sont autant de composantes du langage cinématographique qui peuvent éclairer l’analyse des rêves. »
Ce travail l’a d’ailleurs menée à participer à l’organisation, avec le partenariat cinEXmedia, du colloque S’endormir en images : l’impact des contenus audiovisuels sur le sommeil et les rêves. Celui-ci se tiendra le 9 mai prochain, à l’École de technologie supérieure, dans le cadre de la 92e édition du Congrès de l’Acfas. Pour en savoir plus, consultez ce texte d'Olivier Du Ruisseau.