Direction

Santiago Hidalgo
Directeur
Santiago Hidalgo est professeur adjoint sous octroi au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. Il est le directeur du Labo CinéMédias (depuis 2018) et directeur exécutif du partenariat cinEXmedia, « Contribuer au bien-être à l’ère des écrans », portant sur les enjeux sociétaux, pédagogiques et thérapeutiques de l’expérience cinématographique dans une perspective inclusive (2022-2029). En 2019, Hidalgo a cofondé la collection Cinema and technology aux Presses de l'Université d'Amsterdam ainsi que Cinéma et technologie aux Presses de l'Université en 2021. Il codirige toujours ces deux collections. Il est actuellement chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et au Centre d'études avancées en médecine du sommeil et co-responsable de la formation en médias inclusifs au PRAXIS Centre de développement professionnel.

André Gaudreault
Fondateur
Historien reconnu du cinéma des premiers temps et pionnier de la narratologie filmique, André Gaudreault s’intéresse tout particulièrement, dans le cadre de ses recherches actuelles, à l’avènement du montage, au phénomène de la retransmission d’opéras en salles de cinéma, aux innovations technologiques envisagées dans une perspective « archéologique » et à l’impact du numérique sur l’univers médiatique. Il est l’un des cinq fondateurs de l’Association internationale pour le développement de la recherche sur le cinéma des premiers temps (Domitor), qu’il a dirigée, à titre de premier président élu, de 1985 à 1994. Il a fondé en 1992, et dirige depuis lors, le Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des institutions cinématographique et scénique (GRAFICS); il a aussi assumé, de 1997 à 2005, la direction d’une autre infrastructure interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche basée à l’Université de Montréal, le Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI), dont il est l’un des quatre fondateurs. Il a créé en 2010, à l’Université de Montréal, avec le réalisateur et producteur Denis Héroux, l’Observatoire du cinéma au Québec (OCQ), un carrefour universitaire unique en son genre qui vise à encourager les échanges entre praticiens et théoriciens du cinéma. Il est également l’un des fondateurs et le directeur du Partenariat international de recherche sur les techniques et technologies du cinéma (TECHNÈS), qui réunit depuis 2012 dix-huit partenaires et quarante-cinq chercheurs de différents pays qui se sont donné pour objectif de réintégrer la dimension technique dans la réflexion scientifique sur le cinéma, afin de mieux comprendre les mutations technologiques et leurs interactions avec la théorie, l’esthétique et la pratique du cinéma. En 2016, il a fondé le Laboratoire CinéMédias, une infrastructure rattachée à la Chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques qui englobe, outre TECHNÈS, le GRAFICS et l’OCQ, le Programme de recherche sur l’archéologie et la généalogie du montage/editing (PRAGM/e).

Thomas Carrier-Lafleur
Directeur adjoint et coordonnateur de la recherche
Professionnel de recherche et chargé de cours à l’Université de Montréal, Thomas Carrier-Lafleur est directeur adjoint et coordonnateur de la recherche du Laboratoire CinéMédias. Dans une perspective intermédiale qui s’intéresse aux processus de transposition écranique des textes littéraires, ses recherches portent sur la littérature française et québécoise ainsi que sur le cinéma québécois. Il est notamment l’auteur de Voir disparaître. Une lecture du cinéma de Sébastien Pilote (L’instant même, 2021), Projections croisées. Dialogues sur la littérature, le cinéma et la création avec Andrée A. Michaud et Simon Dumas (Figura, 2021), Impression, projection. Une histoire médiatique entre cinéma et journalisme (PUL, 2019 ; avec Richard Bégin et Mélodie Simard-Houde) et Il s’est écarté. Enquête sur la mort de François Paradis (Nota bene, 2019 ; avec David Bélanger — Prix Jean-Éthier-Blais 2020). Il est également codirecteur de Nouvelles vues. Revue sur les pratiques, les théories et l’histoire du cinéma au Québec.
Coordination
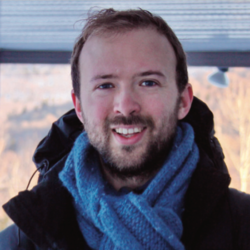
Rémy Besson
Coordonnateur scientifique de TECHNÈS
Professionnel de recherche et coordonnateur scientifique dans le cadre du partenariat international de recherche TECHNÈS, Rémy Besson a soutenu un doctorat à l’EHESS (Paris), portant sur la mise en récit du film Shoah de Claude Lanzmann (C. Delage dir.). Il a été stagiaire postdoctoral du Centre de Recherches Intermédiales sur les arts, lettres et techniques (CRIalt, Montréal, 2012-14) où il a assuré la coordination scientifique du projet international Archiver à l’époque du numérique, puis au LLA-CREATIS (Toulouse II, 2014-15) où il a poursuivi ses travaux sur l’intermédialité. Spécialiste reconnu des rapports entre histoire, sciences humaines, culture numérique et cinéma, il est également chargé de cours. La liste de ses publications est accessible en ligne : http://remybesson.blogspot.ca/

Zoey Cochran
Co-directrice du thème « Convergence par le rythme » du partenariat cinEXmedia
Bio à venir

Rosalie Carignan
Adjointe à la coordination et responsable de production audiovisuelle
Détenant une maîtrise en cinéma réalisée en 2023 à l'Université de Montréal sous la direction de Bernard Perron, Rosalie Carignan s’intéresse aux enjeux de représentation, au cinéma de genre et au féminisme avec une sensibilité marquée pour les questions de « race » et les politiques « étrangenres ». Son mémoire porte d’ailleurs sur l'horreur cinématographique et la justice sociale à l'ère de Black Lives Matter et du #MeToo. Rosalie rejoint le Laboratoire CinéMédias en 2021 à titre d’auxiliaire technique contribuant à la production et à la post-production audiovisuelle du Laboratoire, exerçant notamment dans le cadre des activités de l'Observatoire du cinéma au Québec. Rosalie agit maintenant en tant que responsable de la section audiovisuelle du Laboratoire en plus d'assister à la coordination de l'équipe du Laboratoire CinéMédias.

Tara Karmous
Coordonnatrice principale et adjointe à la Chaire de recherche en études cinématographiques et médiatiques
Après une maîtrise de cinéma en recherche-création sous la direction d’Olivier Asselin, Tara Karmous devient agente à la coordination de la Chaire de recherche en études cinématographiques et médiatiques. Ses études se concentraient sur l’usage de la géolocalisation et de la réalité augmentée dans une perspective activiste. Dans le cadre du Lab_Artenso, elle poursuit sa réflexion avec la création d’un prototype intitulé La Fin des paillassons un projet de réalité augmentée invitant à réviser le discours patriarcal en histoire de l’art. Depuis 2021, Tara est également auxiliaire de recherche sur le projet OpéRA de Poche dont l’objectif est de créer des opéras pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour documenter le processus de recherche-création.
Communications

Marnie Mariscalchi
Responsable des publications
Marnie Mariscalchi est conseillère à la recherche à l’Université de Montréal et responsable des publications du Laboratoire CinéMédias. Elle a été successivement responsable de la diffusion, secrétaire de rédaction, puis éditrice de la revue d’études cinématographiques Cinémas, pour laquelle elle a travaillé de 2007 à 2024. Parallèlement, elle a collaboré à plusieurs projets de recherche, principalement dans le cadre des travaux du GRAFICS, à titre d’auxiliaire de recherche, d’assistante éditoriale et d’adjointe à la coordination. Elle a étudié le cinéma et l’histoire de l’art à l'Université de Montréal.

Olivier Du Ruisseau
Responsable des communications du partenariat cinEXmedia
Titulaire d’un Baccalauréat ès beaux-arts (BFA) avec double majeure en histoire de l’art & études cinématographiques et journalisme à l’Université Concordia, Olivier Du Ruisseau travaille à la fois dans les médias et dans le milieu culturel, tandis qu’il complète sa maîtrise de recherche en cinéma à l’Université de Montréal sous la direction d’André Habib. Reporter, journaliste culturel et critique de cinéma et d’arts visuels, il travaille au journal Le Devoir et collabore à Médiafilm, entre autres. Il a aussi occupé plusieurs postes au sein de divers festivals de cinéma, dont programmateur au Festival International du Film sur l’Art (FIFA) et rédacteur pour le Festival du nouveau cinéma. Il est également animateur au festival Cinéma sous les étoiles et au FIFA, ainsi que membre du comité de présélection du FIFA. Ses recherches récentes portent justement sur l’apport des festivals aux discours critiques et académiques sur le cinéma québécois.
Soutien technique et production audiovisuelle

Thomas Rapenne
Auxiliaire à la production audiovisuelle
Thomas Rapenne est étudiant en maîtrise d'études cinématographiques à l’Université de Montréal depuis septembre 2018 sous la direction d’André Gaudreault. Ses recherches et ses créations se concentrent sur les images d’interfaces graphiques (principalement d'ordinateur et de smartphone) au cinéma. Il travaille comme chargé de post-production auprès du partenariat TECHNÈS et détient un baccalauréat en Arts du spectacle parcours Images obtenu à l’Université Lyon 2 (France).

Hiba Chaari
Auxiliaire à la production audiovisuelle
Bio à venir
Professionnel·les de recherche

Pierre Chemartin
Pierre Chemartin est chercheur, critique cinématographique et chargé de cours en études cinématographiques. Ses activités se concentrent sur la bande dessinée et le cinéma d'animation.

Alex Delagrave
Chargé de projet, collections numériques
Diplômé en études cinématographiques (Université Concordia) et en sciences de l’information (Université de Montréal), Alex Delagrave a orienté son parcours vers l’archivistique audiovisuelle, avec un intérêt marqué pour les enjeux de diffusion. Au laboratoire, il est impliqué dans les projets de recherche ou de valorisation faisant appel à ses champs d'expertise : gestion de collections numériques, conception de structures de métadonnées, traitement et analyse documentaires, et édition numérique. Il participe notamment à la création de l'encyclopédie numérique TECHNÈS, travaille sur un projet d’annotation vidéo d’entretiens filmés et contribue à l'organisation de colloques virtuels. Il agit également comme programmateur, projectionniste et animateur d’ateliers de création auprès de plusieurs organismes et collectifs liés au cinéma.

Louis Pelletier
Titulaire d’un doctorat en communication de l’Université Concordia, Louis Pelletier est professionnel de recherche et chargé de cours à l'Université de Montréal, où il a par ailleurs complété un projet de recherche postdoctoral financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada sur les premières expériences de production de films de fiction au Québec. Il est également chercheur en résidence à la Cinémathèque québécoise, coordonnateur scientifique du Canadian Educational, Sponsored and Industrial Film Project de l’Université Concordia et codirecteur de Nouvelles vues. Il a publié sur le cinéma muet, le cinéma industriel, le cinéma amateur, l’exploitation cinématographique, l'histoire technique du cinéma et le cinéma d’avant-garde dans Film History, 1895, The Moving Image, The Journal of Film Preservation, la Revue canadienne d'études cinématographiques et Found Footage. Il complète présentement le manuscrit d'un ouvrage portant sur la distribution et l'exploitation cinématographique à Montréal entre les années 1912 et 1952.
Postdoctorant·es

Baptiste Creps
Chercheur postdoctoral
Baptiste Creps est chercheur postdoctoral et chargé de cours à l’Université de Montréal. Il est spécialisé sur l’histoire des formes cinématographiques, hollywoodiennes en particulier, sur la musique de film et sur les notions de classicisme et de néoclassicisme à travers l’histoire de l’art. Ses recherches et publications portent également sur l’étude des technologies numériques, des médias et du jeu vidéo dans une perspective intermédiale. Il a enseigné auparavant à l’Université Gustave Eiffel, à l’Université Rennes 2 et à l’Institut Catholique de Paris.

Caroline Martin
Chercheuse postdoctorale
Chercheuse postdoctorale (FRQSC, 2020-2022) au Laboratoire CinéMédias, Caroline Martin est chargée de cours en littérature et cinéma depuis plus de 15 ans. Elle est diplômée Maître ès arts en études littéraires (UQÀM) et Philosophiæ Doctor en éducation artistique (Université Concordia). En 2018, elle a été élue par les étudiants comme l’une des cinq enseignantes les plus inspirantes de l’Université de Montréal. Ses intérêts de recherche incluent l’éducation cinématographique et médiatique, la réception chez les jeunes publics et l’audiodescription. En collaboration avec l’ŒIL cinéma (Outil pour l'Éducation à l'Image et au Langage CINÉMAtographiques), elle mène une recherche à l’échelle provinciale auprès des enseignantes et enseignants du secondaire intégrant le cinéma dans leur cursus. Elle est actuellement représentante des chargées et chargés de cours du département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques (Université de Montréal) et fait partie du comité consultatif de la série de cours en Médias inclusifs de la Chang School of Continuing Education (Ryerson University).

Claudia Polledri
Chercheuse postdoctorale
Postdoctorante et chargée de cours au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques (UdeM), Claudia Polledri est titulaire d’un doctorat en littérature comparée de l’Université de Montréal portant sur les représentations photographiques de Beyrouth (1982-2011) et sur le rapport entre photographie et histoire. Elle a été chercheuse invitée au LLA-CRÉATIS (2016) et a assuré la coordination scientifique du CRIalt (Centre des recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques) entre 2015 et 2018. Ses intérêts de recherche portent sur le cinéma et la photographie au Maghreb et au Moyen-Orient. Elle a été commissaire de l'exposition photographique Iran : poésies visuelles présentée dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie (2019).
Auxiliaires de recherche

Robin Cauche
Étudiant au doctorat
Monteur vidéo de formation, Robin Cauche a d’abord travaillé comme responsable de postproduction d’une chaîne de télévision musicale. Ses recherches portent sur l’histoire et l’esthétique des chansons illustrées. Il a étudié en particulier les Scopitones, puis les lyric videos. Professeur certifié de lettres modernes, il est également chargé de cours en lettres et en études cinématographiques. Depuis 2016, Robin Cauche est doctorant en Études cinématographiques et audiovisuelles sous la cotutelle de Martin Barnier (Université Lumière Lyon 2) et d’André Gaudreault (Université de Montréal). Sa thèse porte sur les « chansons lumineuses écrites », formes audiovisuelles affichant à l’écran les paroles des chansons qu’elles illustrent, des lanternes magiques à YouTube (XIXe – XXIe). « Chercheur associé à la Cinémathèque Française » (2016-2017), il a reçu en 2018 le prix de l’Essai Étudiant de l’association DOMITOR pour ses recherches sur les crises de l’industrie des illustrated songs aux États-Unis en 1907-1908.

Louis-Philippe Hamel
Étudiant au doctorat
Doctorant depuis 2018 au département d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, Louis-Philippe Hamel prépare une thèse sur la spécificité stylistique de la science-fiction à l’ère de la normalisation des effets visuels numériques. Il est sous la direction de Richard Bégin, qui avait aussi dirigé son mémoire de maîtrise traitant de l’influence du concept du « cool » sur le genre du film de crime dans les années quatre-vingt-dix. Ses recherches actuelles portent donc sur le cinéma numérique, les effets visuels (et spéciaux) et la science-fiction—et sur leurs enjeux périphériques, qu’il explore notamment au sein de présentations comme celle sur la reconnaissance et l’organisation du travail dans le domaine des effets visuels qu’il a pu offrir en 2019 dans le cadre du colloque TECHNÈS « Gestes singuliers, gestes collectifs : histoire et cinéma en pratiques ».

Frédérique Khazoom
Étudiante au doctorat
Frédérique Khazoom a complété sa maîtrise à l’Université de Montréal dans le cadre du programme « International Master of Audiovisual and Cinema Studies », ce qui l’a mené à fréquenter des établissements renommés en Europe, tels l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III (France) et l’Universiteit van Amsterdam (Pays-Bas). Elle s’intéresse à la manière dont les différentes sphères du paysage télévisuel contemporain s’adaptent aux changements provoqués par la convergence entre Internet et la télévision. Dans son projet doctoral, elle tente de comprendre comment les possibilités de la plateforme en ligne Netflix affectent la façon dont celle-ci s’adresse aux téléspectateurs et la manière dont ces derniers expérimentent la télévision en tant que membres d’un public désormais mondial. Elle collabore également avec le Labo Télé (Université de Montréal) dirigé par Marta Boni depuis 2018.

Simon Laperrière
Étudiant au doctorat
Simon Laperrière est doctorant en études cinématographiques sous la direction de Richard Bégin. Ses recherches actuelles portent sur les fan théories, la culture populaire et la surinterprétation. Il a codirigé avec Eric Falardeau le collectif Bleu nuit : Histoire d’une cinéphilie nocturne (Somme toute, 2014). En 2018, il publie Series of Dreams : Bob Dylan et le cinéma aux Éditions Rouge Profond. Collaborateur du projet audiovisuel Zoom Out, il a signé divers articles pour Hors champ, Spirale et 24 images et participe régulièrement à l’émission Plus on est fous, plus on lit (Ici Première). Avec Simon Lacroix, il codirige la série de projections excentriques Les nuits de la 4e dimension au Cinéma du Parc.

Alice Michaud-Lapointe
Étudiante au doctorat
Alice Michaud-Lapointe est candidate au doctorat au département d’études cinématographiques de l’Université de Montréal et chargée de cours. Sa thèse porte sur les liens qui unissent la cinéphilie aux concepts de hantise et de mémoire dans le cinéma contemporain. Elle fait partie du comité de rédaction du magazine culturel Spirale, dans lequel elle a co-dirigé un dossier (« Le temps du rétro ») avec André Habib. Outre ses textes critiques parus chez Spirale, elle a publié dans les revues Liberté, Études Françaises, Found Footage Magazine, Nouvelles Vues et les plateformes Mise au point et Hors Champ. Elle est également autrice aux éditions Héliotrope, où elle a publié un recueil de nouvelles (Titre de transport, 2014), un roman (Villégiature, 2016) et un récit de voyage (Néons et sakuras, 2018). Elle est auxiliaire de recherche au GRAFIM depuis 2019.

Katia Andrea Morales Gaitan
Étudiante au doctorat
Katia Andrea Morales Gaitan est doctorante en études cinématographiques et médiatiques et assistante à la coordination du Programme de recherche sur l’archéologie et la généalogie du montage/editing (PRAGM/e). Elle a obtenu un Master en cinéma documentaire avec mention honorable à l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), qui lui a décerné la Médaille Alfonso Caso en 2018. Dans le cadre de son Master, Katia a effectué un séjour de recherche à la faculté d’ingénierie de l’Universidad del Desarrollo, à Santiago, Chili. Elle a obtenu une licence en sociologie de l’Université autonome d’État du Mexique (UAEMex) et a réalisé un échange académique avec l’Université Lyon Lumière 2, France. Elle a dirigé la recherche « L’état des publics du circuit culturel de Mexico » à la demande de ProcineDF. Katia a enseigné la production et l’histoire du cinéma documentaire et collaboré avec plusieurs institutions telles que la Cineteca Nacional, l’UNAM et l’Universidad Iberoamericana. En 2014, elle a travaillé comme coordonnatrice pour FilminLatino, plateforme de VOD d’IMCINE. Membre de l’équipe de coordination pour la conférence Latin Side of the Doc 2013, elle a contribué au développement de la communauté Ouishare en plus d’animer des ateliers pour la Banque interaméricaine de développement (BID).

Marwan Saad
Étudiant à la maîtrise
Après avoir complété un baccalauréat en Histoire, une majeure en études cinématographiques et une mineure en sciences de la communication, Marwan Saad entame en 2020 sa maîtrise avec André Gaudreault sur les plateformes de diffusion en continu et leurs impacts sur les salles de cinéma. Ses champs d’intérêts se concentrent sur l’histoire du cinéma, le développement des technologies et le numérique au cinéma.

Alice Guilbert
Étudiante à la maîtrise
À mi-chemin entre le Canada et la France, Alice Guilbert étudie l’histoire de l’art et l’archéologie à Paris dans l’Université Panthéon-Sorbonne avant de revenir à Montréal pour entamer un baccalauréat en cinéma à l’Université de Montréal. Elle intègre le laboratoire CinéMédias en 2019 en tant qu’auxiliaire de recherche.

Lisa Melinand
Étudiante au doctorat
Lisa Andrée Mélinand, doctorante en études cinématographiques sous la direction de Santiago Hidalgo et assistante de recherche pour Caroline Martin, se consacre à l'accessibilité et à l'inclusion dans le cinéma et les médias, avec un accent particulier sur les personnes handicapées, racisées et LGBTQIA2+. En tant que personne racisée, neuroatypique et sourde oralisante non signante, elle apporte une perspective unique à ses recherches. Ses études en France l'ont amenée à envisager un cinéma thérapeutique, inclusif, accessible et écologique, concept au cœur de sa thèse doctorale. Elle aspire à créer un site de streaming adapté aux besoins des publics en situation de handicap. Durant son master, Lisa a pris conscience des défis d'accessibilité dans le cinéma, la motivant à promouvoir une industrie plus inclusive. Elle a initié un programme de tutorat à l'Université Paul Valéry Montpellier III, incluant des capsules vidéo éducatives et une journée de projection-rencontre avec le Dr Jean Victor Leblanc, pour discuter du rôle du cinéma dans la représentation des troubles psychiques. Lisa poursuit ses recherches avec détermination, visant à enrichir le cinéma pour toustes.

Tanzia Mobarak
Étudiante au doctorat
Bio à venir.

Romina-Soledad Romay
Étudiante au doctorat
Romina S. Romay est une compositrice, cheffe d’orchestre et pianiste d’origine argentine, engagée dans des travaux de création en lien avec des nouvelles technologies, et abordant fréquemment des thématiques relatives à la nature, au vivant et à l’écologie.
Initialement formée au piano, elle a par la suite suivi des études supérieures en composition musicale à l’Universidad Nacional de las Artes à Buenos Aires, en Argentine.
Elle a obtenu un master international en composition et performance de la musique contemporaine au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, avec des résidences en Estonie, en Suède et en Allemagne, puis a réalisé un doctorat en composition musicale micro tonale à partir de métadonnées à l’Université Côte d’Azur à Nice, en France. En tant qu’ingénieure d’études pour le XR²C² (Extended Reality Research and Creative Center), elle contribue aux réalisations de résidences artistiques, de journées d’étude et de projets de recherche en relation avec des applications de VR, AR et MR.

Marianne Abi-Nahed
Étudiante à la maîtrise
À la suite de l'obtention de son diplôme de baccalauréat en cinéma, Marianne Abi-Nahed poursuit actuellement son programme de maîtrise en études cinématographiques à l'Université de Montréal sous la direction d'André Gaudreault. Elle a intégré le Laboratoire CinéMédias en tant qu'auxiliaire de recherche en 2022. Ses intérêts de recherche se concentrent sur la théorie, l'esthétique et le langage cinématographique, ainsi que sur les complexités psychologiques du récit.

Lou Andrysiak
Étudiante à la maîtrise
Lou Andrysiak est diplômée d’un baccalauréat en Littératures de langue française à l’Université de Montréal. Durant son parcours, elle s’intéresse aux questions d’adaptation cinématographique, de pratiques culturelles et médiatiques ou encore d’édition. Depuis 2022, elle est auxiliaire de recherche pour Thomas Carrier-Lafleur. Dorénavant au DESS en journalisme, elle a intégré l’équipe de cinEXmedia afin de participer à la rédaction d’articles pour le site Web.

William Pedneault-Pouliot
Étudiant à la maîtrise
William Pedneault-Pouliot a complété un baccalauréat en histoire et un certificat en histoire de l’art en 2022 à l’Université Laval, à Québec. Il poursuit présentement des études à la maîtrise à l’Université de Montréal au sein du programme International Master in Cinema Studies, sous la direction du professeur André Gaudreault. Il s’intéresse à l’histoire du cinéma dans une perspective interdisciplinaire, et plus particulièrement aux liens qui unissent le cinéma et les arts. Son sujet de mémoire portera sur le rôle joué par les artistes et les écrivains de l’avant-garde dans la conceptualisation du montage cinématographique en France dans les années 1910 et 1920. Il est auxiliaire de recherche au sein du Laboratoire CinéMédias depuis 2023.

Hugo Samson
Étudiant au baccalauréat
Après avoir complété un diplôme collégial en cinéma, Hugo Samson entreprend un baccalauréat en littérature comparée à l'Université de Montréal. Il s'intéresse aux théories de l'intermédialité ainsi qu'à l'intersection entre l'art et la politique dans les espaces culturels comme les musées et les théâtres. Pour le Laboratoire CinéMédias, il rédige des articles pour le site Web et assiste le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques.
