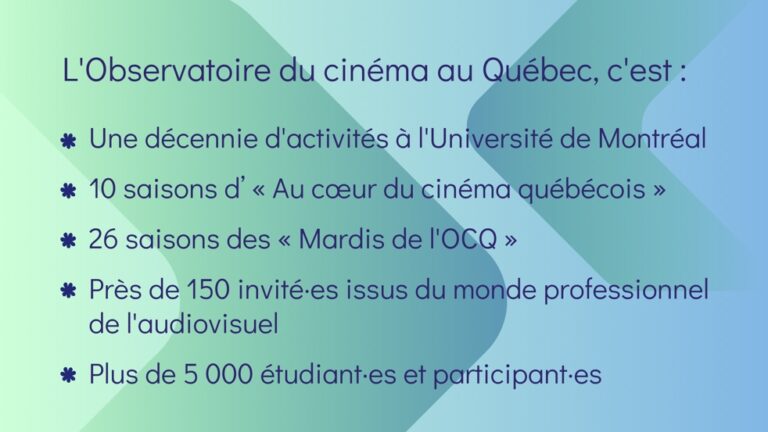Le chercheur membre de cinEXmedia a analysé l’évolution des dispositifs audiovisuels de captation de mouvements, des premiers temps du cinéma à l’ère de l’intelligence artificielle, lors d’une conférence à l’Université de Montréal.

Olivier Du Ruisseau
Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle, Laurent Guido était l’invité des Grandes conférences de la Chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques, le 1er avril dernier. Sa présentation, intitulée « Fantasmagories automatiques : entre scènes et écrans, capter le rythme entraînant du corps-spectacle », portait sur l’évolution des dispositifs audiovisuels de captation de spectacles et de mouvements corporels, des débuts du cinéma aux premières applications de l’intelligence artificielle.
Historien du septième art et spécialiste des liens entre film, corporéité et musique ainsi que des théories du spectaculaire dans les médias, Laurent Guido est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont L’Âge du rythme (2007), De Wagner au cinéma (2019) et Cinéma, mythe et idéologie (2020). C’est d’ailleurs en raison de son intérêt pour le rythme et le cinéma d’attraction, entre autres, qu’il est devenu membre de cinEXmedia dès la fondation du partenariat.
Le chercheur a amorcé sa conférence en évoquant les technologies les plus récentes, comme les systèmes de suivi automatisé par caméras utilisés dans les matchs sportifs ou les procédés de montage multicaméra automatisé pour les captations de spectacles. Son objectif : interroger les raisons du développement de ces dispositifs ainsi que les enjeux sociaux et esthétiques qu’ils soulèvent, en les mettant en perspective grâce à un rapprochement avec l’émergence de la chronophotographie et du cinématographe.
« Informatique théâtrale »
Tout au long de sa présentation, le professeur a mis en relation les avancées techniques des deux époques avec les réactions qu’elles ont suscitées chez les artistes et les théoricien·nes. Les textes de l’italien Ricciotto Canudo (1877-1923), pionnier des études cinématographiques modernes, ont servi de fil rouge à sa réflexion.
Dans La Naissance d’un sixième art. Essai sur le cinématographe (1911), Canudo voit dans le cinéma « la grande conciliation non seulement entre la science et l’art, mais entre les rythmes du temps et les rythmes de l’espace ». Selon Laurent Guido, cette formule « renferme l’essence de toutes les questions essentielles qui nous concernent encore aujourd’hui ».
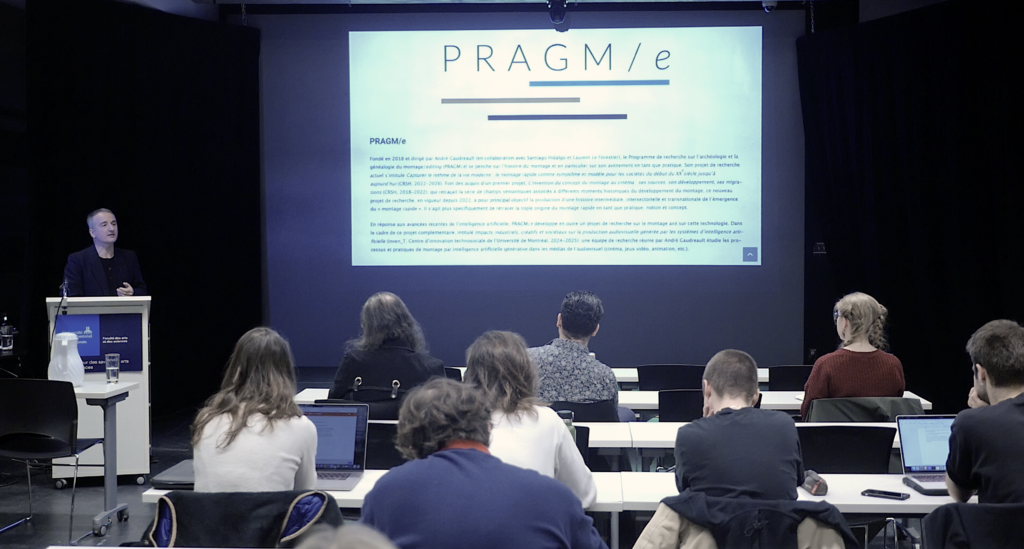
Les propos de Canudo trouvent désormais leur écho dans les travaux récents du chercheur français Rémi Ronfard sur l’« informatique théâtrale », un champ émergent qui étudie comment les technologies peuvent accompagner la conception, la production ou la diffusion de spectacles scéniques. Selon Laurent Guido, l’émergence du cinéma au tournant du XXe siècle et celle de ces nouveaux outils s’inscrivent dans une même dynamique : elles surviennent à un moment où la technique « répond aux préoccupations de [son] époque » par le recours à « des dispositifs permettant de révéler la forme des mouvements ».
Ainsi, dans les années 1910, les images animées étaient mobilisées en médecine pour mieux comprendre les mouvements corporels, par exemple. De nos jours, l’intelligence artificielle est notamment utilisée pour réduire les coûts de production des spectacles ou pour les rendre « plus dynamiques », précise le chercheur.
Entre inquiétudes et promesses technologiques
Si la première moitié de la conférence de Laurent Guido a mis en lumière les correspondances entre ces deux moments historiques, la seconde a mis au jour les inquiétudes que les technologies de captation de spectacles et de mouvements corporels ont suscitées, hier comme aujourd’hui.
« La tension permanente entre corps réel et corps virtuel est l’un des modes de discours récurrents des débats autour de la médiation technique des spectacles scéniques, de l’époque d’Edison jusqu’à la nôtre, a rappelé le chercheur. La simulation technique des prouesses corporelles rythmées n’a cessé d’alimenter les discussions autour des mérites et des dangers inhérents à la diffusion sous une forme immatérielle des performances théâtrales. »
À l’ère du numérique, on assiste à des concerts à distance ou même en co-présence, les spectacles pouvant réunir en temps réel des artistes et des auditoires situés à différents endroits du globe. Si ces dispositifs ouvrent des perspectives inédites, ils soulèvent aussi de nombreuses préoccupations, notamment d’ordre environnemental, puisque les serveurs qui alimentent les systèmes d’intelligence artificielle sont particulièrement énergivores.
Laurent Guido a toutefois conclu sa conférence sur un ton optimiste, en insistant sur le « potentiel révolutionnaire » de ces outils, à condition qu’ils soient mis au service du même « génie créatif humain » – reprenant à nouveau une formule de Canudo – grâce auquel le cinéma a pu devenir une forme d’art à part entière.