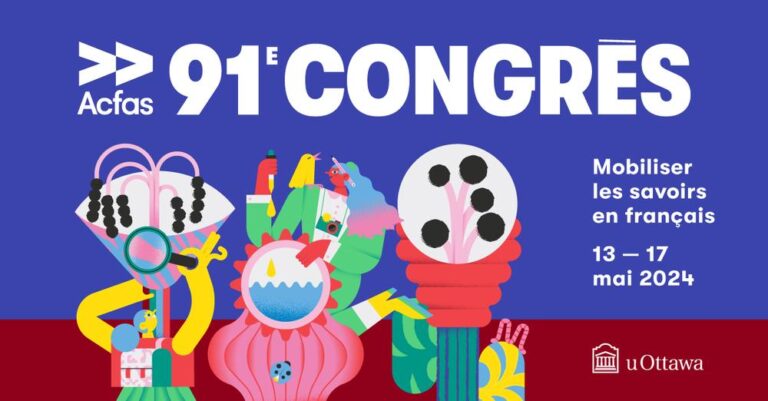Pour la chercheuse, membre du partenariat cinEXmedia, la recherche universitaire doit pouvoir s’exercer à l’extérieur du campus, directement auprès des personnes qu’elle concerne.

Hugo Jacquet
D’abord étudiante en littérature, Alanna Thain découvre ensuite que l’étude du cinéma rejoint davantage ses intérêts de recherche. Le regard analytique qu’elle devait adopter sur la création littéraire portait préjudice, selon elle, à son plaisir des lettres. Au cinéma, la chercheuse estime avoir pu se permettre le contraire : « Les études cinématographiques, dans mon parcours, ont toujours été reliées aux études culturelles et aux études de genre, c’est-à-dire qu’elles s’opposent à l’idée selon laquelle un·e spécialiste peut adopter une distance objective avec son objet de recherche. On accepte l’idée que nous sommes concerné·es par l’objet. »
C’est son intérêt pour le cinéma dans une perspective interdisciplinaire qui a amenée la chercheuse à rejoindre cinEXmedia. Dans les travaux qu’elle effectue au sein du partenariat, elle envisage « les médias comme une manière de vivre avec différents problèmes de santé, notamment des troubles du sommeil, sans recourir à la médicalisation ou à d’autres processus “pathologisants” ». Elle s’intéresse entre autres aux pratiques routinières des personnes qui utilisent les arts médiatiques comme objets de thérapie – en regardant un film ou en allumant la radio pour mieux s’endormir, par exemple. À cet égard, elle se réjouit que les arts ne soient pas « stigmatisants » comme le milieu clinique et que l’on puisse en faire l’expérience à la maison, comme une forme d’autosoin.
L’importance du lâcher prise
Le sommeil est d’ailleurs au centre d’une initiative de recherche-création qu’Alanna Thain a chapeautée entre 2021 et 2023. Intitulé The Sociability of Sleep, son projet interrogeait la fonction sociale du sommeil : « Nous nous sommes inspiré·es du projet Meet to Sleep (2008), de Jasmin Patheja, une activiste féminine indienne qui a proposé à des personnes queer de se réunir pour dormir ensemble dans des lieux publics. Elle a voulu démontrer que les participant·es pouvaient prendre ce risque, malgré les menaces d’agressions sexuelles par exemple. De mon côté, j’ai travaillé sur la nuit urbaine à Montréal, en me demandant comment les sans-abris, privés d’espace à elles et à eux, pouvaient dormir le jour ou la nuit, à l’abri des regards. En fait, on ne veut plus traiter le sommeil comme un problème individuel, mais comme un phénomène collectif. Les médias audiovisuels nous donnent un cadre pour explorer cette forme de sociabilité. »
Alanna Thain dit aussi étudier les mouvements des corps, et notamment l’importance du lâcher prise : « On ne se rend pas compte de toutes les choses hors de contrôle que l’on fait avec notre corps. En danse, on séquence beaucoup les mouvements : 1-2-3-4… Quand on laisse tomber ce découpage, on peut explorer d’autres expressions, d’autres mouvements. » Or perdre le contrôle, c’est se montrer vulnérable. La chercheuse défend ce « droit au risque » dans son approche du cinéma.
C’est entre autres pour cette raison qu’elle s’entoure de nombreux·euses chercheur·euses au sein du Collective for Research on Epistemologies and Ontologies of Embodied Risk (CORERISC), afin d’explorer les notions de danger et de vulnérabilité dans le cinéma d’horreur. « On ne veut pas considérer le danger simplement comme quelque chose à éviter. Vivre une vie complète, c’est avoir le droit de prendre des risques. C’est pour cela que j’étudie le cinéma d’horreur, pour les perspectives qu’il offre là-dessus et sur le monde en général. »
De la science à l’activisme
Les travaux d’Alanna Thain s’inscrivent dans plusieurs domaines et réfléchissent toujours leur sujet en fonction de leur contexte politique. Mais celle qui s’intéresse aux pratiques féministes dans les arts médiatiques, au rôle social du sommeil, au corps ainsi qu’au risque ne considère tout de même pas son activité de recherche comme un geste militant. « Ce n’est pas le sujet que l’on traite qui fait ce que l’on est, dit-elle. On n’est pas féministe parce que l’on travaille sur le féminisme. Il faut vouloir trouver une place pour nos recherches ailleurs que dans les revues académiques. Il faut converser avec d’autres personnes. J’enseigne des choses très contemporaines, alors j’invite mes étudiant·es à sortir du campus et à rencontrer d’autres ressources, d’autres acteur·rices pour élargir la conversation. »
La chercheuse regrette toutefois que les organismes subventionnaires posent « plus en plus de contraintes au financement des projets ». Elle explique donc vouloir trouver un « juste milieu » : « Il y a une place pour l’expertise, et une autre pour le particulier. La valeur d’une recherche ne dépend pas de son accessibilité au grand public. Mais, en même temps, on ne peut pas rester cloisonné·es dans une petite communauté d’expert·es. C’est aussi ça, l’intérêt de rejoindre cinEXmedia : on va solliciter d’autres publics. Je vais sortir de mon cadre habituel, et ça m’intéresse beaucoup. »