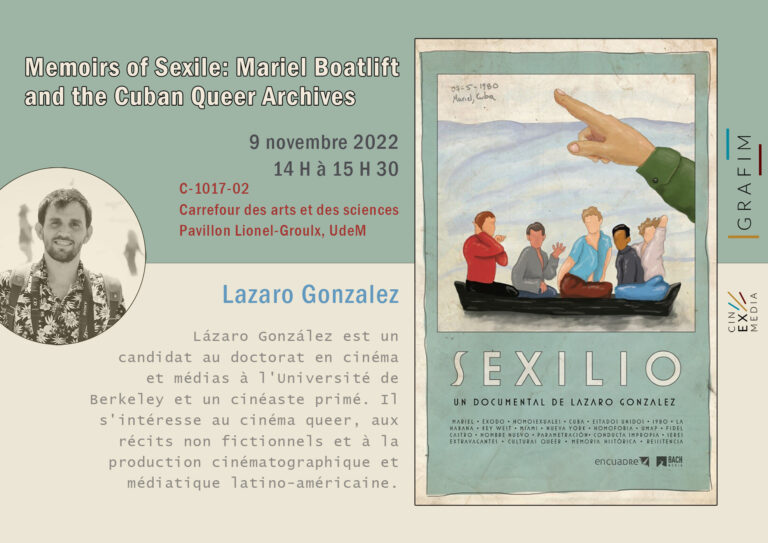Thomas Carrier-Lafleur revient sur le cours offert pour la première fois l’été dernier, à l’Université de Montréal, qui a été pensé comme un prolongement des activités du partenariat cinEXmedia.
Sophie Leclair-Tremblay

cinEXmedia souhaite multiplier ses activités pédagogiques à l’intersection du cinéma et des sciences naturelles dans les prochaines années. Un nouveau cours présenté l’été dernier à l’Université de Montréal est devenu le premier à s’inscrire dans cette perspective. Conçu sous la forme d’un séminaire favorisant la discussion, il accueillait chaque semaine des invité·es issu·es des milieux académique et culturel, qui abordaient un sujet de leur choix.
Les thématiques proposées dans ce cours créé par Santiago Hidalgo étaient inspirées des axes de recherche de cinEXmedia. Elles variaient donc selon les intervenant·es, dont plusieurs étaient des cochercheur·ses du partenariat, couvrant un large éventail de sujets : expériences scientifiques autour du montage, archives audiovisuelles et films orphelins, cinéma scientifique, neurocinéma, ciné-thérapie, etc.
Parmi les participant·es figuraient notamment Isabelle Raynauld, codirectrice de cinEXmedia, Maude Sills-Néron, coresponsable du comité des activités étudiantes du partenariat, ainsi que la cinéaste Caroline Martel. L’astrophysicien Olivier Daigle a ensuite conclu le trimestre avec une conférence intitulée « De la science à la science-fiction ».
« On a trop souvent tendance à enseigner les arts et les sciences naturelles en vases clos », déplore Thomas Carrier-Lafleur, directeur adjoint du Laboratoire CinéMédias et coordonnateur scientifique du partenariat cinEXmedia à qui on a confié l’animation des séances. « Je pense que notre cours est venu combler un manque important, parce que les étudiant·es du département ne soupçonnaient pas à quel point le cinéma pouvait être imbriqué avec la science », poursuit-il.
Le reflet d’une histoire riche
Le chercheur explique le septième art est régulièrement envisagé sous un angle scientifique dans les milieux académiques. Dans les premiers temps du cinéma, précise-t-il, le cinématographe était perçu comme une invention technologique, inscrite dans les avancées scientifiques de la fin du XIXe siècle, telles que la capture inédite du mouvement des êtres vivants et la recherche en optique.
Qu’il s’agisse de fiction ou de documentaire, le cinéma est également à la fois un outil de vulgarisation scientifique, et de poétisation du scientifique. « Encore aujourd’hui, après toutes ses transformations, le cinéma permet de révéler une forme de poésie dans la science que celle-ci ne peut montrer seule », remarque l’animateur du séminaire. Il cite à titre d’exemples le cinéma de Jean Painlevé ou encore le projet Cadavre exquis, dirigé par André Habib, cochercheur membre de cinEXmedia qui est également intervenu lors du cours.
Enfin, le cinéma peut directement contribuer à la recherche en sciences naturelles. La ciné-thérapie, par exemple, explore les vertus thérapeutiques du cinéma, qu’il s’agisse de programmer des films pour des clientèles ciblées ou d’analyser ses effets psychologiques et physiologiques. Thomas Carrier-Lafleur mentionne à cet égard certains projets sur le sujet menés par le Laboratoire CinéMédias, lesquels ont fait l’objet d’une présentation par les doctorant·es Yann Guizaoui et Lisa Mélinand dans le cadre du cours. Coresponsable des activités étudiantes de cinEXmedia, Lisa Mélinand aborde d’ailleurs la question sous l’angle de l’accessibilité et de l’anticapacitisme dans sa recherche doctorale.
C’est pourquoi Thomas Carrier-Lafleur estime que les études cinématographiques doivent « être prises au sérieux, comme tous les autres champs de recherche ». « Le cinéma, grâce à sa nature profondément accessible, peut avoir de profonds impacts sur nos vies. Il est essentiel de continuer à l’étudier en profondeur, et cela doit passer, entre autres, par une considération scientifique. »