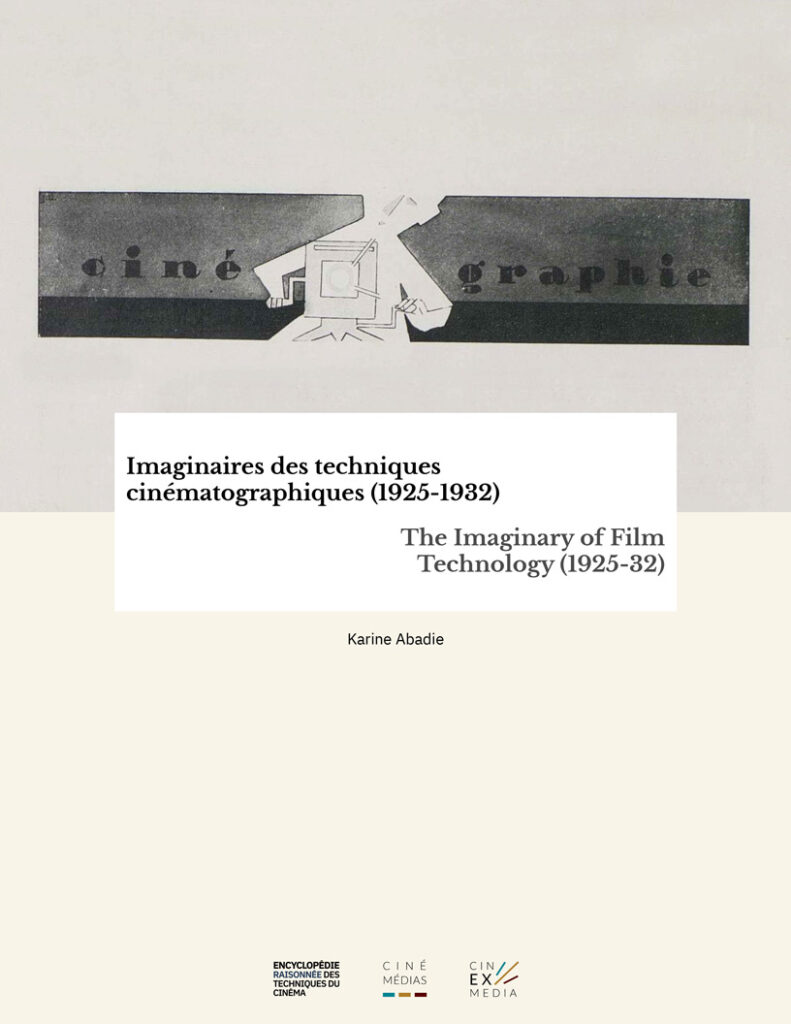Par Karine Abadie
Le cinéma existe par une série d’opérations mécaniques et techniques réalisées dans le but de proposer à un public un produit fini, fixé sur un support et compris par les créateurs et les spectateurs comme étant une oeuvre d’art. Mais cette dimension technique, tout en étant l’objet d’une fascination, constitue aussi un repoussoir pour ceux qui refusent d’admettre l’association entre cinéma et art. Que cache en fait ce terme parapluie de « technique », utilisé de manière imprécise dans une pluralité de contextes discursifs ? En nous plaçant du point de vue des discours, nous interrogerons comment des imaginaires des techniques cinématographiques se construisent dans les pages de quatre revues françaises spécialisées – Cinéma, Cinémagazine, Cinéa-Ciné pour tous et Photo-Ciné – entre 1925 et 1932, des années riches en bouleversements. Les arrêts proposés dans ce livre montreront la construction d’un imaginaire pluriel, composé de manifestations et de motifs révélant les potentialités du cinéma.