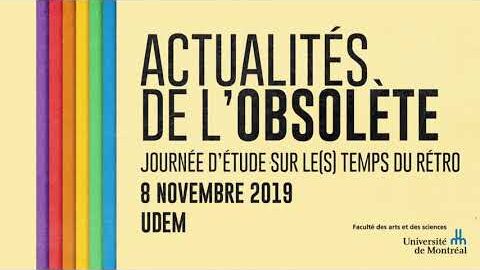Le codirecteur de cinEXmedia a participé, avec des chercheuses du Laboratoire CinéMédias, au colloque international « Couper/générer. Le montage à l’épreuve de l’IA », qui s’est tenu le 26 avril dernier, à Paris.

William Pedneault-Pouliot
Le colloque « Couper/générer. Le montage à l’épreuve de l’IA », qui s’est tenu du 24 au 26 avril 2025 à la Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, à Paris, était organisé par le Laboratoire International de Recherches en Arts et par l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel, avec la collaboration de l’Institut Universitaire de France. L’événement invitait plusieurs chercheur·ses, praticien·nes et artistes à interroger les implications de l’intelligence artificielle (IA) sur le concept et la pratique de montage.
André Gaudreault, codirecteur de cinEXmedia et du Laboratoire CinéMédias, y a participé aux côtés de la professionnelle de recherche Marie-Odile Demay, de la stagiaire postdoctorale Anna Kolesnikov et de la candidate au doctorat en études cinématographiques Tanzia Mobarak.
« Montage global »
La communication d’André Gaudreault et de Marie-Odile Demay, intitulée « L’IA à l’épreuve du montage : journal d’une expérimentation », retraçait les étapes du parcours de recherche de l’équipe depuis le moment où elle a commencé à s’intéresser plus sérieusement à l’intelligence artificielle, en avril 2024. « À l’origine, nous voulions aborder son impact sur l’ensemble de la société, explique André Gaudreault. Puis, nous avons plongé dans les notions de montage et de rythme. »
Un point tournant est survenu dans ce parcours en septembre dernier, lorsque l’artiste multidisciplinaire Alain Omer Duranceau, avec qui le Laboratoire CinéMédias collabore pour son projet DÉMARRER (2024 – BRDV, Université de Montréal), a fait parvenir à l’équipe un court métrage qu’il avait réalisé en deux jours avec l’aide de l’intelligence artificielle. Intitulé Neither Man Nor Movie Camera, celui-ci est inspiré de L’Homme à la caméra (1929), de Dziga Vertov. « Nous avons voulu comprendre, en prenant exemple sur ce film, en quoi la chaîne de production d’une œuvre audiovisuelle pouvait être modifiée par l’IA », poursuit le professeur Gaudreault.
C’est pourquoi il a développé, avec Marie-Odile Demay, une « cartographie » permettant de « quantifier l’apport humain dans la création faite avec l’intelligence artificielle », dit-il. Les chercheur·ses ont constaté, par exemple, que dans le court métrage d’Alain Omer Duranceau, le montage des images avait été effectué par l’artiste lui-même, car « les modèles de diffusion n’étaient pas capables de faire du montage », souligne Marie-Odile Demay.

Précisons qu’un modèle de diffusion, notamment utilisé pour la génération d’images (mais aussi de sons ou de textes dans certains cas), est un type de modèle génératif fondé sur un processus probabiliste. Celui-ci simule la manière dont une donnée, comme une image, peut être progressivement « détruite » par l’ajout de bruit aléatoire, puis reconstruite à l’envers par le modèle. Le bruit correspond à l’information soustraite, qui rend la donnée de plus en plus floue, déformée ou méconnaissable. Des outils comme DALL·E 2, Stable Diffusion ou Midjourney reposent sur ce type de modèle.
Fort·es de ces découvertes, les chercheur·ses se sont engagé·es dans une série d’expérimentations avec l’aide d’Alain Omer Duranceau et de Yann Guizaoui, qui est quant à lui candidat au doctorat en études médiatiques, spécialiste des interactions humain-machine. « On a décidé de forcer le modèle à faire des coupes, explique Marie-Odile Demay. On a réussi, mais les résultats étaient peu concluants. »
L’équipe a fait de premiers essais avec des systèmes propriétaires, comme le logiciel Sora de la compagnie OpenAI, puis avec le modèle de diffusion en open source du logiciel Hunyuan Video, développé par la compagnie chinoise Tencent. « L’open source nous a permis d’observer le processus de l’IA et de constater que le modèle de diffusion, par la manière dont il fonctionne fondamentalement, fait du montage à même ses processus de génération d’images », ajoute Marie-Odile Demay.
Pour qualifier ce montage effectué à la source même de la génération d’image par les modèles de diffusion, les deux chercheurs ont mis de l’avant la notion de montage « global » – en référence à la notion d’« image globale » développée à l’origine par le cinéaste et théoricien Sergueï Eisenstein. André Gaudreault compare d’ailleurs l’émergence de la réalisation de films au moyen de l’IA aux premiers temps du cinéma : « Pour moi, la sortie de Sora, qui permet de créer des vidéos à partir de prompts, c’est une première mondiale, au même titre que la première projection publique payante des frères Lumière au Grand Café, en 1895. »
Dziga Vertov, entre la révolution numérique et le pastiche postmoderne
Anna Kolesnikov et Tanzia Mobarak se sont elles aussi inspirées du court métrage d’Alain Omer Duranceau, mais avec un angle différent de celui privilégié par leurs collègues, pour leur conférence intitulée « Neither Man Nor Movie Camera : Vertovian Kino-Pravda Meets Alain Omer Duranceau’s Pastiche ».
Les deux chercheuses se sont plus précisément intéressées à celui qui a réalisé le film original de 1929, Dziga Vertov : « Nous souhaitions nous concentrer sur Vertov, non seulement en tant que sujet de ce pastiche, mais aussi en tant que personne qui, par ses écrits et sa pratique cinématographique, a été une source d’inspiration pour la compréhension de la révolution numérique, explique Anna Kolesnikov. Nous voulions mettre en lumière le potentiel de l’étude des écrits et des œuvres de Vertov dans les réflexions actuelles sur l’esthétique de l’IA. »
Les deux films étudiés ont ainsi été les points de départ d’une réflexion plus large sur la création et sur le concept de « pastiche postmoderne » à l’ère de l’intelligence artificielle. « Nous avons mis en parallèle l’œuvre originale de Vertov et celle d’Alain Omer Duranceau avec d’autres œuvres produites à l’aide de l’IA qui s’en inspirent, en commentant l’émergence de certains partis pris inhérents à l’intelligence artificielle », souligne Tanzia Mobarak.
Il s’agissait pour les chercheuses d’observer la manière dont certains certains partis pris, ou préjugés, peuvent peuvent se glisser dans l’écriture des prompts et dans leur visualisation subséquente par l’IA. « Par exemple, contrairement au film original, dans Neither Man Nor Movie Camera, l’accent est mis sur la caméra et non sur la figure du monteur. De même, les femmes qui figuraient en bonne place dans le film de Dziga Vertov disparaissent dans le film d’Alain Omer Duranceau », précise Anna Kolesnikov.
Les deux communications ont donc permis à André Gaudreault et son équipe de diffuser les résultats d’une année de recherches collectives, tout en mettant chacune de l’avant une approche distincte et inédite, jumelant à la fois l’étude des premiers développements du montage cinématographique et l’expérimentation avec les plus récents modèles de diffusion issus de l’intelligence artificielle.